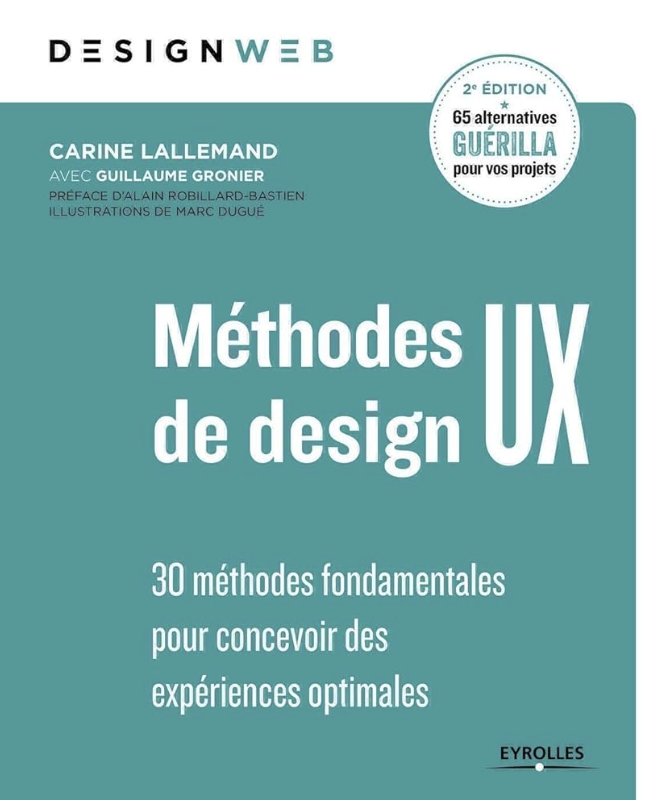Qui est David Leblanc, l’auteur de Usines à Impact ?
Quels éléments pourraient donner toute sa crédibilité à mon livre ?
La réponse m’a conduit à vous raconter l’histoire de ma passion pour le défi et l’innovation ci-dessous. Bonne lecture !
Apprendre. Créer. Partager.
Ces trois verbes ont toujours rythmé ma vie — bien avant que je découvre qu’ils formaient le socle d’un mouvement : celui des Makers.
Un Maker, c’est quelqu’un qui ne se contente pas de poser des questions : il construit des réponses. Littéralement. Avec ses mains, son cerveau, son énergie. C’est quelqu’un qui expérimente, qui bidouille, qui teste, qui apprend par l’action avant de chercher la théorie. C’est un esprit curieux, parfois obsessionnel, toujours animé par l’envie de comprendre en faisant. Et surtout : c’est quelqu’un qui partage ce qu’il apprend, pour que d’autres puissent aller plus loin, plus vite, autrement.
 Moi, je fais partie de cette tribu-là. Présentez-moi une énigme au début d’un repas, et vous risquez de perdre ma présence mentale jusqu’au dessert. Certains problèmes me poursuivent des mois, voire des années. Tant que je n’ai pas trouvé une réponse qui tienne debout, je ne lâche rien. Mais réfléchir ne suffit pas : j’ai besoin de vivre la réponse, de la tester, de la construire moi-même, dans la vraie vie, là où ça bouge, là où ça rate, là où ça apprend.
Moi, je fais partie de cette tribu-là. Présentez-moi une énigme au début d’un repas, et vous risquez de perdre ma présence mentale jusqu’au dessert. Certains problèmes me poursuivent des mois, voire des années. Tant que je n’ai pas trouvé une réponse qui tienne debout, je ne lâche rien. Mais réfléchir ne suffit pas : j’ai besoin de vivre la réponse, de la tester, de la construire moi-même, dans la vraie vie, là où ça bouge, là où ça rate, là où ça apprend.
Et une fois que j’ai compris quelque chose, je n’ai qu’une envie : le transmettre. L’exposer. Le confronter à d’autres regards pour continuer à progresser. Et c’est cet état d’esprit maker qui irrigue tout ce livre. Je vous propose de faire connaissance ici en vous exposant quelques-unes des questions qui ont littéralement changé ma vie.
« Comment développe-t-on un logiciel ? »
C’est la question qui m’obsédait à 15 ans. A l’époque, je suivais un baccalauréat en Sciences et Techniques Industrielles spécialisé en électronique. Internet était encore facturé à la minute et faisait fureur chez les adolescents de mon âge. L’Internet mobile s’appelait le WAP et ne faisait pas rêver. Les lycéens devaient patienter longuement pour accéder aux quelques postes informatiques disponibles pour leurs recherches, et les documentalistes devaient gérer les flux de ces utilisateurs de plus en plus nombreux avec des montres et chronomètres. Pour résoudre ce problème, j’ai développé un logiciel simple mais efficace : il gérait le trafic grâce à des compteurs, utilisait un synthétiseur vocal pour annoncer la fin des temps d’utilisation, et produisait un rapport quotidien des consommations. Ce projet a été une révélation. Porté par cet élan, j’ai ensuite créé une dizaine d’outils destinés à différents publics, que je diffusais sur mon site personnel trousseaoutils.com. A la fin de mon cursus de lycéen, j’ai eu la chance d’avoir comme sujet technique celui d’un robot suiveur de lignes doté d’un système de détection d’obstacles. C’est là que j’ai pu faire le lien entre la programmation informatique, l’électronique et la robotique. Cette passion grandissante m’a naturellement conduit à poursuivre des études d’ingénieur dans les systèmes d’information, à la croisée de l’électronique et de l’informatique, au sein de l’ESIEA, une école d’ingénieurs de spécialité informatique et électronique.
 « Comment de simples idées deviennent-elles de grandes innovations ? »
« Comment de simples idées deviennent-elles de grandes innovations ? »
Nouvelle question obsédante de mes 20 ans, à mi-parcours de mes études. Je constituais rapidement une équipe pour développer les premiers éléments d’un robot ainsi que les documents de conception nécessaires.
 L’année suivante, je décidais de lancer le projet Aquatis dont l’objectif était clair : neuf mois pour réaliser un robot sous-marin autonome dans le cadre du concours SAUC-E organisé par l’OTAN. Ce concours mettait en compétition les plus grandes universités Européennes. En 2010, grâce à une équipe soudée et passionnée de 14 étudiants, nous arrivions fièrement en finale de la compétition.
L’année suivante, je décidais de lancer le projet Aquatis dont l’objectif était clair : neuf mois pour réaliser un robot sous-marin autonome dans le cadre du concours SAUC-E organisé par l’OTAN. Ce concours mettait en compétition les plus grandes universités Européennes. En 2010, grâce à une équipe soudée et passionnée de 14 étudiants, nous arrivions fièrement en finale de la compétition.
Sonné. C’est le mot que j’emploierais pour décrire le lendemain du concours. Nous avions réussi à aller bien au-delà de nos objectifs, j’avais passé deux années avec de courtes nuits et sans pause pour contribuer à ce résultat, et la fin du concours signifiait pour moi la fin brutale d’un projet. Je regardais alors autour de moi, me rendant compte que j’avais raté quelque chose d’important : passionné et submergé par les problématiques technologiques, je ne trouvais pas le sens de ce que nous avions réalisé. Où la robotique se cachait-elle dans notre quotidien ? Quelle était son utilité au-delà de celle promue par le concours de dérisquer les champs de mine sous-marins et éviter les marées noires ?
J’ai donc débuté mes recherches, créé le blog shyrobotics.com, et commencé à écrire pour partager mes trouvailles et obtenir des réactions. En deux ans, j’ai publié 450 articles qui m’ont aidé à comprendre dans quel secteur j’avais mis le pied. Le site connut un beau succès, attirant jusqu’à 600 visiteurs uniques par jour, et me permit de rencontrer des personnalités fascinantes — parmi lesquelles un député français, Bruno Bonnell, auteur de Viva la robolution, qui m’avoua connaitre mon blog. Entre-temps, je rencontrais Frédéric Boisdron, co-fondateur et rédacteur en chef du magazine Planète Robot, lors d’un événement Apérobo. Il m’ouvrit la porte à un nouveau rôle : celui de journaliste spécialisé en robotique pour le magazine Planète Robots. Ceci en parallèle de mon activité professionnelle à plein temps. Mes premiers entretiens me conduisirent à échanger avec des figures majeures du domaine, comme Colin Angle, fondateur d’iRobot, et Rodney Brooks, directeur pendant 15 ans du laboratoire d’intelligence artificielle du MIT.
Certains lecteurs réticents ont commencé à réagir. Ils m’alertaient d’une crainte que la robotique ne devienne un secteur abominable qui allait supprimer l’emploi, remettre en question les postes dédiés aux handicapés moteurs, peut-être même remplacer les conjoints dans les couples, etc. Je me rendais compte que le sujet que je considérais comme purement technique était également un sujet économique et social.
C’en était assez ! Ma curiosité était touchée et je devais être capable de répondre à ces attaques à l’encontre de la robotique ! Je ne pouvais plus continuer à publier mes articles sans apporter de réponse à cette question qui revenait trop souvent. Mais les questions qui se posaient pour la robotique se posaient pour de nombreux autres secteurs. Et les réponses se trouvaient dans un concept bien plus vaste et complexe à comprendre : l’Innovation. Un terme que l’on voit affiché partout aujourd’hui, sans vraiment comprendre sa signification.
A partir de 2013 et durant trois années consécutives, je cherchais à comprendre ce qu’était l’innovation, comment elle fonctionnait, comment donner du sens à ce que je créais, quelles étaient les différentes formes d’innovation et leur point commun, quel était le rapport entre l’invention et l’innovation, et surtout quels leviers d’action je pouvais tirer de tout cela. Je multipliais les rencontres et les enquêtes : je réalisais des interviews d’entrepreneurs comme Paul Benoit, fondateur de Qarnot Computing, Massimo Banzi, cofondateur d’Arduino, ou encore Milie Taing, fondatrice de Lili.ai. J’échangeais également avec des chercheurs et des directeurs d’incubateurs, de SATT (Sociétés d’Accélération du Transfert de Technologies) et de pôles d’innovation. En parallèle, je menais de longues sessions de recherche à la Bibliothèque nationale François-Mitterrand au milieu de publications scientifiques et de revues universitaires. Ceci aboutit à la publication de mon livre Smart World en 2017.
En parallèle de ces recherches, je vivais aussi une aventure professionnelle passionnante chez Dassault Aviation, où j’évoluais du poste de développeur à des responsabilités de gestion de projets et de produits internes pour servir l’ensemble des usines du groupe.
« Comment les makers ont démocratisé l’innovation ? »
Au fil de mes explorations dans le monde de l’innovation, j’ai été frappé par l’émergence de lieux atypiques qui cherchaient à démocratiser l’accès à des outils de production autrefois réservés aux usines des grands groupes industriels : les FabLabs, Makerspaces et Hackerspaces. Ces espaces, souvent communautaires, ouvraient leurs portes à tous, en échange d’un abonnement modeste, et mettaient à disposition un véritable arsenal technologique : cartes Arduino, fraiseuses numériques (CNC), imprimantes 3D, découpeuses laser, stations de soudure, et bien plus encore.
Là, chacun pouvait inventer, réparer, détourner ou fabriquer des objets par soi-même. Mieux encore : il était possible d’explorer d’immenses bibliothèques en ligne de modèles open source — outils, composants, pièces détachées — de les télécharger, de les personnaliser, puis de les repartager une fois améliorés. Le tout, rendu tangible grâce aux machines disponibles sur place. Certains projets étaient simples, comme un support de téléphone à imprimer en quelques minutes ; d’autres beaucoup plus ambitieux, comme la fabrication complète d’un drone à partir de plans, de schémas électroniques et de tutoriels librement accessibles.
C’était fascinant.
C’est à ce moment-là que j’ai compris que ces initiatives n’étaient pas isolées. Elles s’inscrivaient dans un mouvement mondial né au début des années 2000, rassemblant des passionnés de technologie, de bricolage, de design et d’artisanat numérique : le Maker Movement. Un mouvement qui célèbre l’ingéniosité, le partage des connaissances et la réappropriation des moyens de production par les citoyens eux-mêmes.
Quand je parle d’innovation, je pense à un bien ou un service qui, jusque-là, n’était pas accessible ou répandu au sein d’une population donnée, et qui parvient à se diffuser jusqu’à devenir un usage courant, voire un standard. Une innovation ne se résume donc pas à une invention. Elle peut être un outil ou une technologie déjà existante, mais qui, par un changement de contexte, de coût ou d’usage, vient enfin rencontrer un nouveau public.
Les grandes entreprises ont appris à industrialiser ce processus. Elles ont structuré des chaînes de production, de distribution et de communication capables de porter une innovation à grande échelle. C’est ce modèle qui a façonné notre monde contemporain : un monde où, en quelques clics, on peut accéder à des milliers de produits standardisés, optimisés, livrés en 24 heures. Mais cette puissance d’industrialisation reposait sur un paradoxe : pour qu’une innovation atteigne ce niveau de diffusion, il fallait d’importants moyens financiers, une forte capacité d’influence, et des volumes suffisants pour justifier les investissements.
C’est là que le Mouvement Maker a introduit une rupture. Comme le décrit Chris Anderson dans son ouvrage La Longue Traîne, le numérique a bouleversé les anciennes logiques de rareté et de standardisation. Dans un monde physique, seules les références les plus rentables pouvaient justifier leur place sur une étagère. Dans un monde numérique, tout ou presque peut exister, même ce qui ne concerne qu’une poignée de passionnés. La « longue traîne », ce sont ces millions de niches, de micro-usages, d’objets à faible diffusion mais à forte valeur individuelle, qui deviennent soudain viables grâce à la baisse des coûts de fabrication, de stockage, et de distribution.
Un exemple parlant est celui de la musique. Pendant des décennies, quelques titres « hits » dominaient les classements et les radios. Tout le monde écoutait les mêmes artistes au même moment, imposés par une logique de diffusion de masse. Aujourd’hui, cette uniformité s’est effacée. Les jeunes écoutent des artistes totalement différents selon les communautés auxquelles ils appartiennent : un rappeur local sur SoundCloud, une chanteuse coréenne issue d’un label indépendant, un beatmaker découvert sur TikTok ou une voix anonyme derrière un remix sur YouTube. Les « hits » existent toujours, mais leur portée est moins universelle. Ils cohabitent avec une infinité de micro-scènes, de fandoms, de tendances éphémères ou hyperlocalisées. Chacun a sa propre bande-son, sa propre scène musicale.
Le Mouvement Maker fonctionne selon une dynamique similaire. Il ne cherche pas à concurrencer les industriels sur leurs standards ou leurs volumes. Il explore les marges : ces objets que les grandes entreprises ne produisent pas car ils sont trop spécifiques, trop créatifs, trop expérimentaux… ou simplement pas assez rentables. Là où l’industrie vise l’uniformité pour rentabiliser la production de masse, le mouvement Maker revendique la personnalisation, la réappropriation, la diversité. Fabriquer soi-même un support de caméra et en partager les plans par solidarité ou pour obtenir une reconnaissance au sein de la communauté, réparer un ancien appareil, adapter un outil à un besoin très particulier : tout cela devient possible, sans dépendre d’un marché de masse ni d’un cycle d’innovation centralisé.
J’ai transformé cette découverte en un documentaire intitulé « Les Makers : Une autre vision de l’innovation » accessible librement sur YouTube, dans lequel la parole est donnée à plusieurs figures emblématiques de cette révolution silencieuse, parmi lesquelles Dale Dougherty, considéré comme l’un des pères du Web 2.0. Dans la foulée, j’ai également été sollicité pour co-organiser les événements Show Me The Maker à Strasbourg, une série de conférences inspirées des TED Talks, mais portées par des personnes « comme tout le monde » : artisans, inventeurs, passionnés, militants, chacun présentant un projet ou une expérience de vie capable d’inspirer le public.
« Comment créer une startup ? »
La grande majorité des Makers reste dans une logique de passion, de curiosité et de partage. Ils créent, modifient, expérimentent, souvent pour le plaisir de comprendre et de transmettre. Mais parmi eux, certains réalisent que leur création répond à un besoin concret. Alors, ils testent l’idée qu’il pourrait y avoir là une opportunité commerciale, une chance de transformer leur contribution en entreprise.
C’est à ce moment précis que les trajectoires des Makers croisent celles des entrepreneurs. L’énergie du garage rejoint celle des incubateurs. Le geste artisanal rencontre l’ambition d’impact. Ces Makers-entrepreneurs rejoignent le mouvement des startups, animé par cette volonté de changer le monde avec des solutions nouvelles, concrètes, souvent portées par un sens aigu de l’utilité. Mais c’est aussi à ce carrefour que le choc survient : l’inventivité se heurte aux réalités du marché, la passion se confronte à la dure loi de l’entrepreneuriat — trouver un modèle économique, convaincre des clients, lever des fonds, tenir dans la durée.
C’est dans ce contexte que j’ai senti l’appel de l’aventure. À l’époque, j’étais en poste chez Dassault Aviation, une entreprise où l’on construit des avions aussi bien que des carrières à long terme. Beaucoup s’y projettent jusqu’à la retraite. J’étais à un moment de ma vie où je constatais que j’avais constitué des équipes autour de projets variés, vécu des réussites enrichissantes, contribué à des dynamiques d’innovation, et pourtant… quelque chose manquait.
Ce qu’il me fallait, c’était l’aventure intégrale. Celle où l’on part de zéro, sans filet. Celle où chaque décision compte, où chaque choix peut créer ou faire tomber un projet. L’aventure de la construction d’une entreprise, pas seulement d’un produit. Créer une vision, bâtir une équipe, convaincre les premiers clients, pivoter quand il le faut, apprendre tout le reste en chemin. Une expérience totale, où l’on façonne non seulement des solutions, mais aussi des emplois, des relations humaines, une culture.
Ingénieur de formation et passionné de technologies, je voulais que mon entreprise soit innovante et technologique, naturellement. La start-up s’imposait comme le format idéal : agile, exigeante, totale. À force de côtoyer des fondateurs inspirants, l’heure était venue de quitter la théorie pour l’action. J’ai donc lancé Lion-up, une entreprise dont la mission initiale était de faciliter les relations entre PME et grands groupes industriels. Au fil du temps, le projet a évolué pour devenir une plateforme dédiée à l’apport d’affaires et au partage de savoirs entre entreprises individuelles et très petites structures.
Avec mon équipe, j’ai endossé tous les rôles à la fois : CEO, CTO, développeur, commercial… et, comme beaucoup de premiers entrepreneurs, j’ai accumulé les erreurs classiques. En bon ingénieur, j’étais parti de l’idée d’une solution sans prendre le temps de comprendre en profondeur les besoins ni de clarifier les rôles de chacun dans l’équipe. Quand cette première approche a échoué, j’ai dû continuer seul, soutenu par une communauté d’entrepreneurs d’une solidarité incroyable.
Après avoir été refusé à trois reprises par l’incubateur local de Strasbourg, j’ai eu la chance d’être sélectionné par Y Combinator — le prestigieux accélérateur de la Silicon Valley qui a vu éclore Airbnb, Dropbox, Stripe, Reddit et bien d’autres licornes — et de suivre son programme Y Startup School de trois mois, ponctué d’un coaching personnalisé. Petit à petit, une première solution a émergé, suffisamment solide pour commencer à intéresser des clients — mais il a fallu deux ans d’efforts acharnés pour y parvenir. Après trois années d’aventure, faute d’avoir réussi à générer un chiffre d’affaires significatif et après avoir misé sur une stratégie de bootstrap inadaptée à mon contexte, j’ai dû me résoudre à céder le projet à l’un de mes clients et à tourner la page. Mais cette fin n’était pas un échec : elle ouvrait au contraire la voie à une nouvelle question, qui était finalement peut-être la première que j’aurais dû me poser…
 « Qu’est-ce qu’un produit ? »
« Qu’est-ce qu’un produit ? »
J’ai longtemps cru qu’un produit se résumait à l’objet que l’on déballe : une montre connectée, un jean en coton bio ou la toute dernière appli mobile. En tant qu’ingénieur, il était évident pour moi que la valeur résidait dans la création de cet objet, et c’est avec cette approche que j’interrogeais mes interlocuteurs dans mes enquêtes. Trois années d’entrepreneuriat m’ont forcé à déplacer le regard. Le « produit » véritable, celui qui crée et capture de la valeur, est un organisme complet, un système ; ce que le client tient dans la main n’en est que la partie visible de l’iceberg.
Prenons le smartphone qui nous accompagne au quotidien. Tout commence bien en amont, dans le grondement lointain des mines de lithium. Viennent ensuite les bureaux d’ingénierie, où l’on modèle les circuits, ajuste les patronages, polit l’interface. L’atelier d’assemblage prend le relais : robots, contrôle qualité, cartons palettisés, transit sous douane, entrepôts régionaux. Jusqu’ici, le consommateur n’a encore rien vu ; pourtant, chaque étape influe déjà sur son futur usage, son prix, sa confiance.
Puis le produit franchit la frontière invisible qui sépare l’usine du marché. Les analystes marketing déroulent leur funnel : ciblage, storytelling, A/B tests. Sur Instagram, l’image d’un smartphone surgit dans le flux de l’acheteur potentiel ; il ignore qu’un algorithme le sélectionne parce que son comportement digital ressemble à mille autres profils convertis la veille.
La scène se déplace dans une boutique lumineuse ou sur une page d’e-commerce. Là, un vendeur formé en trois modules e-learning vante une autonomie record ; un moteur de recommandation propose l’étui assorti. Au clic de validation s’active la logistique inverse des retours, la gestion des numéros de série, la passerelle de paiement. Le client, lui, n’a perçu qu’un « Ajouter au panier ».
Vient l’instant charnière : la première mise sous tension. Un emballage sans frustration, un guide d’onboarding limpide — ce sont des mois de design et d’écriture qui atterrissent en quelques secondes d’expérience fluide. Si un bug survient, un chatbot apparaît ; derrière, un centre d’assistance basé sur un autre continent, une base de connaissances nourrie par l’intelligence artificielle et les FAQ d’hier.
La vie du produit commence alors véritablement. Des webinaires guident la découverte d’une fonction cachée ; une mise à jour nocturne corrige un défaut d’autonomie ; un courriel propose un programme de reprise — et son pendant discret : la chaîne de recyclage qui récupérera, démontera, réinjectera la matière première. À chaque étape, des algorithmes scrutent l’usage, alimentant la roadmap des versions futures.
Ainsi, le smartphone, la chaussure biodégradable ou le logiciel SaaS ne sont que la pointe de l’iceberg. Sous la surface, une architecture invisible relie opérateurs télécoms, entreprises de logistique, équipes de support, data scientists, juristes, marketeurs, agronomes et recycleurs. C’est cette totalité, de la mine au SAV, du premier clic publicitaire à l’e-mail de renouvellement, qui mérite le nom de « produit ». Comprendre un produit, ce n’est donc pas contempler un bel objet ; c’est explorer l’océan qui le porte, couche après couche, jusqu’à découvrir que chaque interaction — acquisition, usage, service, fidélisation — forme un nœud du même réseau.
Lorsque mon aventure entrepreneuriale a touché à sa fin, je cherchais un poste qui me garderait au cœur de la création — là où se rencontrent besoin client, faisabilité technique et viabilité économique — tout en m’épargnant la totalité du costume d’entrepreneur. J’ai fini par découvrir le métier de Product Manager. Le Product Manager orchestre l’ensemble des activités qui permettent au produit d’exister : recherche utilisateur, design, développement, marketing, et pilote des indicateurs clairs. Son horizon s’arrête à la livraison d’un résultat mesurable pour le client et pour le chiffre d’affaires. L’entrepreneur, lui, doit embrasser l’ensemble du système : créer ou déraciner un marché, lever des fonds, recruter, gérer la trésorerie, négocier avec partenaires et investisseurs, parfois même changer de cap sous la pression des circonstances. Cependant, dans toute cette complexité du système qu’est le produit, le Product Manager ne travaille pas seul…
« Comment construire une équipe performante ? »
Une entreprise, un produit… ça ne se construit jamais seul. Je l’ai toujours su, et j’ai eu la chance, très tôt, de vivre l’intensité de la création d’une équipe rassemblée autour d’un objectif commun. Mais ce que m’ont appris mon expérience entrepreneuriale, le Product Management, et le Lean Management découvert chez Dassault Aviation, va bien au-delà de la simple dynamique collective.
L’aventure entrepreneuriale m’a confronté de plein fouet aux réalités du terrain : comprendre les enjeux business, jongler avec les contraintes, prendre des décisions rapides avec des ressources limitées. Le Product Management m’a apporté la structure méthodologique, les outils pour passer de l’intuition à l’action raisonnée, et une approche systémique centrée sur le client et l’utilisateur. Le Lean Management, enfin, m’a offert un regard en flux : une capacité à penser en chaînes de valeur, à détecter les gaspillages, à fluidifier les processus sans sacrifier l’impact.
Quand on observe de l’extérieur la construction d’une entreprise, d’une vision, d’une équipe, on pourrait croire à un chaos permanent. Tout bouge, tout semble incertain, et la réussite donne souvent l’illusion qu’elle tient à la chance. Mais derrière ce tumulte, il existe bel et bien une logique. Une logique qui permet non seulement d’être efficace — atteindre un objectif — mais aussi d’être efficient : avancer avec justesse, en mobilisant le minimum d’énergie pour le maximum de résultat. C’est d’ailleurs un principe fondamental en Product Management : le minimum d’effort pour le maximum d’impact.
C’est avec ce regard que j’ai analysé mon expérience à l’issue de mon projet de startup. J’ai pris le temps de faire un vrai bilan : qu’est-ce qui m’avait manqué pour aller plus loin ? Quelles compétences me faisaient défaut pour mieux naviguer dans l’incertitude ? De cette réflexion est né un plan de formation personnel, à la fois théorique et pratique. J’ai enchaîné les formations et les certifications en agilité, en product management, en gestion de projet, en développement logiciel, en Lean Six Sigma… et j’ai naturellement orienté ma trajectoire vers un nouveau cap : la recherche d’un poste de Product Manager, au croisement de la vision stratégique, de la rigueur opérationnelle, et de la création de valeur concrète.
Alors que je venais tout juste d’entamer ma recherche, j’annonçais en parallèle à mes partenaires la fermeture de mon entreprise. Certains tentaient encore de me convaincre de continuer, persuadés que l’idée avait du potentiel et qu’il suffisait de lui laisser un peu plus de temps pour décoller. Mais un autre échange a pris une tournure inattendue.
L’un de nos partenaires techniques — Outscale, l’entité cloud du groupe Dassault Systèmes, qui hébergeait alors la plateforme de Lion-up — m’a immédiatement parlé d’une opportunité en cours : un poste de Product Manager venait de s’ouvrir dans leurs équipes. Cette proposition n’était pas un hasard. Elle était le fruit de la relation de confiance que nous avions construite au fil de mon aventure entrepreneuriale, faite de discussions techniques, de partages de vision et de résolution de problèmes concrets.
C’est ainsi que j’ai rejoint le groupe Dassault Systèmes. Un nom emblématique, qui porte dans son ADN une vision profondément systémique du produit — à la fois rigoureuse, technologique et ambitieuse. Dans l’industrie, on le sait : lorsqu’un produit bouscule ses frontières — qu’il s’agisse d’une fusée SpaceX, d’un train à sustentation magnétique, ou d’une citadine électrique capable d’abriter son propre jumeau numérique dans le cloud — il y a de fortes chances que les solutions de Dassault Systèmes soient à proximité.
Ce passage de l’entrepreneuriat au grand groupe n’a pas été une rupture, mais une continuité naturelle, guidée par les valeurs que je porte : la création de valeur utile, la maîtrise de la complexité, et la volonté de faire avancer les choses, à toutes les échelles. J’y ai vu l’occasion de réinventer ma trajectoire et j’ai décidé d’y mettre toute mon énergie. J’ai continué de me former au product management en même temps que je le pratiquais, grâce au e-learning, aux organismes spécialisés, à des lectures de référence, et des meetups.
Six mois après mon entrée chez Outscale, on me confie le développement d’un nouveau produit stratégique : une marketplace cloud destinée à diversifier l’offre de services face à une clientèle en forte croissance. Tout était à construire. J’ai reçu carte blanche pour constituer l’équipe et appliquer concrètement mes apprentissages. J’ai donc commencé par imaginer une structure d’équipe et une organisation capables de porter le projet. J’ai pu calibrer les flux de production, rédiger les fiches de poste, estimer le coût précis de chaque poste de dépense, et construire un plan complet, détaillé et chiffré. C’est sur la base de ce travail préparatoire que nous avons levé plusieurs millions d’euros auprès de BPI, convainquant les décideurs de la solidité de notre vision et de notre approche, et avec en prime un communiqué ministériel soutenant l’initiative.
 Grâce aux fonds obtenus, le schéma d’organisation que j’avais dessiné est sorti du papier pour prendre corps. J’ai piloté chaque étape : rédaction des fiches de poste, choix des cabinets pour les consultants, entretiens — qu’il s’agisse de prestataires ou de futurs CDI — et installation d’un parcours d’onboarding complet. Parallèlement, j’affinais la vision produit et la stratégie de lancement. Je n’étais pas seul pour autant. C’est un point important de ce livre également : on ne réussit jamais seul, loin de là. Des collègues de tous horizons ont prêté main-forte : les RH, les juristes, le service IT, la communication interne, l’équipe finance, la R&D, etc. Chacun, sur son périmètre, a joué le jeu.
Grâce aux fonds obtenus, le schéma d’organisation que j’avais dessiné est sorti du papier pour prendre corps. J’ai piloté chaque étape : rédaction des fiches de poste, choix des cabinets pour les consultants, entretiens — qu’il s’agisse de prestataires ou de futurs CDI — et installation d’un parcours d’onboarding complet. Parallèlement, j’affinais la vision produit et la stratégie de lancement. Je n’étais pas seul pour autant. C’est un point important de ce livre également : on ne réussit jamais seul, loin de là. Des collègues de tous horizons ont prêté main-forte : les RH, les juristes, le service IT, la communication interne, l’équipe finance, la R&D, etc. Chacun, sur son périmètre, a joué le jeu.
Résultat : nous avons assemblé une escouade de plus de vingt talents complémentaires — product managers, designers, développeurs, ingénieurs QA, administrateurs systèmes, rédacteurs techniques — la colonne vertébrale indispensable pour concevoir, déployer et opérer un produit ambitieux. En juin 2023, à peine neuf mois après l’arrivée de la première recrue, nous avons officiellement mis en ligne notre marketplace cloud : la preuve tangible qu’un projet mené de front, soutenu par l’enthousiasme transversal des équipes, peut passer du croquis à la réalité en un temps record.
Cette expérience s’est révélée d’une richesse inestimable. Travailler au quotidien sur un produit vivant, au sein d’une équipe soudée, me confronte sans cesse à mes propres limites, m’obligeant à formuler de nouvelles questions et à apprendre toujours davantage. Et quoi de mieux qu’une marketplace pour accélérer cet apprentissage ? Un tel produit concentre non seulement toutes les problématiques classiques du développement, mais aussi celles, plus complexes et passionnantes, du marketing, du commerce et des partenariats, avec la diversité de leurs modèles économiques.
Depuis la création de cette équipe et l’atteinte des objectifs fixés, de nouvelles sollicitations sont venues à moi. J’ai pu partager mes apprentissages et découvrir d’autres situations d’autres personnes, qu’elles soient internes ou dans d’autres entreprises grâce notamment aux Product Meetup SXB que j’ai co-fondé à Strasbourg — ma ville depuis 2017 — avec l’association Alsace Digitale. Il s’agit d’une communauté dédiée au Product Management afin de faire rayonner ces pratiques sur la rive du Rhin.
« Comment accompagner une organisation déjà existante dans l’adoption des pratiques produit agiles ? »
C’est cette première question qui m’a lancé dans l’écriture de l’ouvrage que vous êtes en train de découvrir. Elle est née d’un moment simple en apparence, mais profondément révélateur. Au détour d’un café, un collègue me demandait comment il pouvait mettre en pratique la philosophie agile sur un produit physique, et je me suis brutalement rendu compte de mon incapacité à transmettre clairement mes apprentissages à mes pairs. Ce décalage m’a frappé. Pour mon propre développement et la réussite de mes projets, j’avais su provoquer des opportunités de feedback, suivre de nombreuses formations, multiplier les lectures, mettre en place une dynamique d’amélioration continue au sein de mon équipe. Mais je ne savais pas encore comment transposer cette approche pour accompagner efficacement d’autres personnes ou organisations.
Pour répondre à ce besoin d’accompagnement, j’ai décidé d’écrire, non pas un manuel de « changement », mais un récit de création. À mes yeux, c’est en revenant aux fondations — là où naissent la culture produit, l’agilité et l’esprit d’expérimentation — que l’on comprend le mieux comment faire évoluer une organisation déjà installée.
Aussi, beaucoup de dirigeants préfèrent aujourd’hui bâtir ou acquérir une entité entièrement neuve, déjà imprégnée de la culture et des pratiques visées, puis y faire migrer talents et activités. Les géants de la tech l’ont compris depuis longtemps : il est souvent plus rentable d’inoculer une culture fraîche dans une structure vierge et d’y transférer, par vagues, les équipes d’une organisation vieillissante, que de tenter de déraciner de vieilles habitudes. Construire un organisme neuf, porteur de l’ADN désiré, revient moins cher — en énergie comme en délais — que de remanier un colosse ancré dans ses processus historiques.
Prenez Google et sa galaxie d’acquisitions : lorsqu’il rachète YouTube, Nest ou DoubleClick, il ne cherche pas d’emblée à greffer de force la mentalité « Google » sur chaque couloir. Au contraire, il laisse les jeunes pousses grandir dans leur terre d’origine — tribus réduites, sprints rapides, obsession utilisateur — puis invite progressivement les employés des divisions plus anciennes à rejoindre ces structures « starter ». Résultat : les ingénieurs issus de la recherche publicitaire plongent dans la culture YouTube, découvrent le culte du créateur et ramènent avec eux l’exigence de data-driven qui manquait parfois à l’équipe vidéo.
Ainsi, mon constat est simple : il est toujours plus facile de démarrer de zéro pour construire des pratiques de travail agiles et une culture produit solide, que de transformer une organisation existante, façonnée par son histoire, ses expériences, ses habitudes bien ancrées, ses intérêts parfois divergents, et les frustrations accumulées au fil du temps. À mes yeux, une part essentielle du succès des entreprises de la Silicon Valley réside dans leur capacité à se réorganiser dynamiquement et à remettre en cause régulièrement leurs propres modes de fonctionnement pour atteindre un nouvel optimum d’efficacité et d’innovation.
C’est la raison pour laquelle ce livre peut également être utilisé dans le cadre d’une transformation d’entreprise.
« La performance de l’équipe et la qualité du produit sont-ils les seuls piliers du succès ? »
En 1996, le Web ressemblait à une immense bibliothèque sans classement. Des pages éparpillées, des liens brisés, des moteurs balbutiants incapables de distinguer l’utile du bruit. Pour trouver un site, on tapait son adresse exacte si on la connaissait, on suivait des liens depuis d’autres pages, ou on naviguait via des annuaires thématiques comme Yahoo! Directory ou DMOZ. On découvrait des sites par bouche-à-oreille, sur des forums, ou en recourant à des moteurs approximatifs comme AltaVista, souvent plus frustrants qu’efficaces.
C’est dans ce chaos fascinant que deux doctorants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, se plongent, au cœur du Digital Libraries Project, un programme financé par la NSF et la DARPA. Dans le sous-sol de l’université, ils imaginent une autre manière de cartographier le Web : non plus en comptant les mots-clés, mais en analysant les liens entre les pages, comme des votes de confiance. Ainsi naît PageRank, un algorithme qui deviendra le cœur d’un moteur de recherche radicalement nouveau.
En septembre 1998, Google Inc. est fondée à Menlo Park. Moins de deux ans plus tard, la jeune entreprise gagne en crédibilité : la NASA propose d’héberger l’un de ses premiers data-centers sur la base d’Ames, et la Maison-Blanche adopte son moteur pour alimenter le portail FirstGov. Ces premiers contrats publics jouent un rôle décisif : ils valident la robustesse technologique du moteur, rassurent les annonceurs, et positionnent Google non plus comme une promesse, mais comme un acteur crédible — prêt à entrer dans l’orbite des géants du Nasdaq.
Comment tout cela a-t-il été rendu possible ? En prenant du recul, en repensant aux nombreuses conversations et interviews que j’ai eu la chance de mener avec des entrepreneurs de renom, une question s’impose : qu’est-ce qui fait réellement la différence dans un parcours ? En confrontant ces témoignages à mes propres réussites, certains leviers apparaissent avec constance. Ce sont ces filets invisibles qui nous soutiennent sans bruit : un certain niveau d’éducation, un environnement stable, l’accès à des infrastructures — qu’elles soient numériques, physiques ou institutionnelles. Autant de fondations discrètes, mais décisives, sur lesquelles s’érigent les réussites individuelles.
Mais s’il y a un levier qui, à mes yeux, fait vraiment la différence — et sur lequel chacun peut agir — c’est le réseau. Aucun des projets que j’ai menés n’a été porté seul. Derrière chaque réussite, il y a eu des échanges, des coups de pouce, des connexions humaines, à commencer par la famille, les amis, les camarades de promotion et les collègues.
Le réseau, ce n’est pas juste une liste de contacts. C’est une infrastructure invisible qui soutient l’action. Il apporte des conseils au bon moment, des opportunités imprévues, des expertises complémentaires, parfois même des coéquipiers ou futurs associés. C’est l’énergie collective qui transforme une idée en projet, un projet en réalité. Et quand on regarde bien, c’est souvent dans la qualité des liens qu’on tisse que se joue la différence entre une trajectoire qui stagne… et une trajectoire qui décolle.
Pourtant, dès l’école, on nous conditionne à célébrer le major de promo plutôt que l’équipe qui, ensemble, a relevé un défi impossible. On distribue les lauriers à l’individu le plus brillant, comme si l’économie se nourrissait de performances solitaires. Dans la vraie vie, les succès entrepreneuriaux naissent d’alliances, de complémentarités, de coalitions — tout l’inverse d’un classement qui oppose au lieu de fédérer. C’est tellement évident pour les entrepreneurs que c’est dans leur culture de s’entraider, c’est naturel.
Certains héritent d’un carnet d’adresses ; d’autres doivent le bâtir pierre après pierre. Certains cercles s’ouvrent en accordant la confiance dès le départ, d’autres exigent qu’on prouve d’abord sa valeur avant de laisser entrer. Le monde est ainsi, chacun démarre sur la marche qui lui a été choisie, mais le résultat est collectif. Mesurer un succès ou un échec en ne considérant que sa propre contribution, c’est courir le risque de tourner en rond dans sa propre excellence ou s’enfermer dans la dévalorisation personnelle.
Le réseau replace déjà toute initiative individuelle dans une dynamique plus large, celle d’un ensemble collectif que chacun contribue à faire grandir. Mais la facilité avec laquelle ce réseau se tisse — et la richesse des liens qu’il permet — dépendent d’un facteur encore plus fondamental : l’écosystème dans lequel il prend racine. Car un réseau, aussi prometteur soit-il, ne peut s’épanouir que sur un terreau fertile. Il n’est jamais plus fort que l’environnement qui le nourrit. Un écosystème sain, c’est une réserve de compétences, un système éducatif qui nourrit les idées et les savoir-faire, un climat suffisamment serein pour que l’on ose miser des années sur un pari risqué. C’est aussi une culture du partage d’information, une confiance mutuelle qui fait circuler l’intelligence plutôt que la stocker dans des silos. Surtout, c’est la capacité à capter la valeur créée — revenus, savoir-faire, retombées technologiques — pour la réinjecter aussitôt dans de nouveaux projets. Un territoire qui laisse filer cette richesse se transforme tôt ou tard en friche : les talents s’en vont, les initiatives se tarissent, la roue de l’innovation tourne à vide.
Au début des années 1970, le ciel commercial était dominé par les constructeurs américains. Boeing, McDonnell Douglas et Lockheed régnaient sans partage, et pour les compagnies aériennes du monde entier, acheter un avion signifiait presque toujours acheter américain. Dans ce contexte, l’idée qu’un appareil conçu par une coopération européenne puisse rivaliser relevait plus du pari politique que de l’évidence industrielle. Et pourtant, à force de volontés conjuguées, Airbus est né. Mais il ne suffit pas de créer un consortium pour exister. Il a fallu près de vingt ans pour que cette ambition prenne réellement son envol. Vingt ans pour qu’Airbus passe du statut de projet fragile, soutenu par des aides publiques et quelques commandes institutionnelles, à celui de constructeur crédible aux yeux du marché international.
Dès 1972, l’A300, premier avion produit par Airbus, fait ses débuts. Mais les compagnies restent frileuses, les ventes sont lentes, et le scepticisme persiste. Il faudra attendre le milieu des années 1980, avec l’arrivée de l’A320 et sa technologie de commandes de vol électriques, pour que la donne change. Ce virage marque une rupture : Airbus ne se contente plus de rattraper son retard, il innove, il devance. Et avec cette nouvelle génération d’avions, le constructeur européen commence à grignoter sérieusement les parts de marché des géants américains.
Ce succès ne doit rien à la chance. Il est le fruit d’une coopération longue, patiente, souvent chaotique : des ingénieurs de plusieurs pays apprenant à travailler ensemble, des États finançant malgré les critiques, des compagnies acceptant de jouer le rôle de pionniers. Vingt années d’efforts pour prouver que l’Europe pouvait non seulement rêver d’avions, mais les faire voler.
Les ambitions et les choix doivent être menés en cohérence avec l’écosystème dans lequel ils s’insèrent pour être supportés par le réseau. Un produit marquant naît rarement d’une vision isolée ; il s’enracine d’abord dans un écosystème vivant, existant, puis franchit des paliers. Tout commence avec celles et ceux qui y trouvent un intérêt immédiat : les utilisateurs précoces, les premiers clients, souvent issus du même environnement que les fondateurs. Ils sont proches du besoin, motivés, parfois même impliqués dans la conception, par leurs retours, leurs tests, ou simplement leur enthousiasme contagieux. Ces premiers cercles ne suffisent pas à assurer la viabilité d’un produit, mais sans eux, rien ne démarre. C’est dans cette phase que se forgent les premières alliances de terrain, basées sur la proximité, la confiance, et l’utilité directe.
À mesure que le produit gagne en légitimité, l’écosystème s’élargit. Il intègre de nouveaux profils : intégrateurs, distributeurs, consultants, acteurs publics. Le produit entre dans des appels d’offres. On ne l’achète plus seulement pour soutenir sa vision ou sa qualité, mais aussi pour ce qu’il représente : une alternative crédible, locale, innovante. La solidarité devient alors structurelle. C’est dans cet esprit que des dispositifs comme le Small Business Act américain imposent aux grandes organisations d’ouvrir leurs marchés à des PME, dans une logique d’équilibre et de stimulation de l’innovation.
Quand l’écosystème atteint un certain niveau de maturité, la commande publique entre en scène. Dans le cas d’Airbus, ce sont les États eux-mêmes qui, au nom de leur souveraineté industrielle, ont structuré leur soutien : par des subventions, des investissements, mais surtout des actes politiques. À l’international, les contrats deviennent diplomatiques. L’achat d’avions ou de satellites peut équilibrer des balances commerciales. La réussite du produit dépasse son usage initial : elle devient une affaire d’alliance entre nations, entre blocs économiques, entre modèles de société.
LinkedIn illustre également cette trajectoire. Lancé en mai 2003 par Reid Hoffman, le réseau n’est d’abord qu’un miroir pour les échanges informels de la Silicon Valley : investisseurs, recruteurs et ingénieurs y entretiennent déjà, hors ligne, un marché du talent très liquide. Huit ans plus tard, en 2011, le Department of Veterans Affairs signe un partenariat national de reconversion : tous les soldats démobilisés reçoivent une formation LinkedIn et un abonnement premium gratuit. Ce sceau fédéral agit comme un label de qualité, et la même année, le réseau franchit le cap des 100 millions de membres et entre en Bourse. La courbe d’adoption s’emballe : de 2003 à 2011, LinkedIn était utile ; après 2011, il devient indispensable. Pendant ce temps, en France, Viadeo est oublié.
À chaque palier de croissance, rien n’avance sans la solidarité active de l’écosystème : un réseau où les compétences se complètent comme les maillons d’une chaîne. Un produit progresse parce que certains le conçoivent, d’autres l’adoptent, d’autres le recommandent, d’autres encore le financent ou le protègent. Privée de ce soutien organique, la plus brillante innovation reste lettre morte. Le succès dépend de la capacité des parties prenantes à se reconnaître, à comprendre les contraintes de l’autre, à concilier des intérêts parfois divergents et à avancer de concert.
C’est cette vision de l’innovation qui me pousse, depuis 2018, à m’investir bénévolement au sein d’Alsace Digitale, une association à but non lucratif qui se donne pour mission d’être le hub du numérique en Alsace. Elle fédère les ambitions, développe les compétences et stimule les initiatives innovantes à l’échelle du territoire.
Concrètement, cela se traduit par des meetups, des hackathons, des actions de sensibilisation, et surtout par le développement d’un réseau local vivant. Un réseau qui relie des femmes et des hommes engagés dans le développement économique régional : élus, entrepreneurs, porteurs de projets, étudiants, acteurs privés… mais aussi des bénévoles enthousiastes, convaincus que le numérique peut être un levier d’impact positif et durable pour notre territoire.
Qu’on y croie ou non, qu’un projet semble trop ambitieux ou parfaitement réalisable, nous portons collectivement la responsabilité de nos réussites comme de nos échecs.
« Qu’est-ce que la souveraineté ? »
C’est une question que je ne me suis jamais vraiment posée, mais pour laquelle j’ai obtenu une réponse malgré moi au croisement de mon parcours entrepreneurial et professionnel. Si je devais expliquer la souveraineté à un enfant de cinq ans, je lui raconterai l’histoire suivante qui résume bien ma vision : « Imagine qu’un grand ami te prête son vélo. Au début, c’est juste pour jouer ; puis, comme il n’en a plus besoin, il te dit que tu peux le garder sans limite de temps. Tu t’en sers chaque matin pour aller à l’école ; le vélo devient indispensable. Un an plus tard, ton ami déménage et réclame soudain sa bicyclette.
Du jour au lendemain, tu te retrouves à pied : ta liberté dépendait d’un objet que tu ne possédais pas. C’est ça, perdre un morceau de souveraineté. Si tu l’avais pressenti, tu aurais pu, par exemple, lui prêter tes chaussures préférées, celles qu’il mettrait tous les jours. Elles seraient devenues pour lui aussi vitales que le vélo l’était pour toi. Cette réciprocité vous aurait remis à égalité et, qui sait, il aurait peut‑être fini par te céder définitivement la bicyclette en échange des chaussures. »
La souveraineté, ce n’est pas dominer les autres. C’est rester maître de soi. C’est être en capacité de contribuer, d’agir, de choisir, pour demeurer un partenaire digne de ceux qui nous entourent. C’est la condition pour rester aligné avec ses amis, son corps, son environnement. Et elle se construit chaque jour, par la responsabilité, l’effort, et le respect de soi-même autant que des autres.
Cela relève de choix collectifs, donc politiques. De la même manière que ce livre se concentre sur la mécanique du produit sans prétendre embrasser toute la complexité de la création d’entreprise, il survole à peine l’impact du cadre politique. La politique, c’est la capacité de l’écosystème à se remettre en question et à s’organiser pour faire émerger la réussite commune et relever les défis actuels et futurs. C’est la main invisible qui peut adapter les réglementations, sécuriser le financement de la recherche, offrir des ponts entre écoles et entreprises, concentrer l’investissement sur des secteurs clés pour l’avenir, bref : donner à l’écosystème la capacité de grandir. Sans cet entretien permanent, même les meilleurs réseaux finissent par se faner, les ambitions collectives deviennent des archives de bonnes intentions, et on finit par se dire que l’écosystème n’est qu’un vaste désert qu’il faut quitter pour survivre.
Et pour créer un cercle vertueux, tout commence avec des personnes, des idées, des savoir-faire, et l’envie d’apprendre, de créer, et de partager…