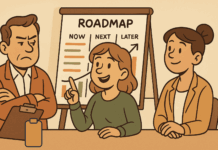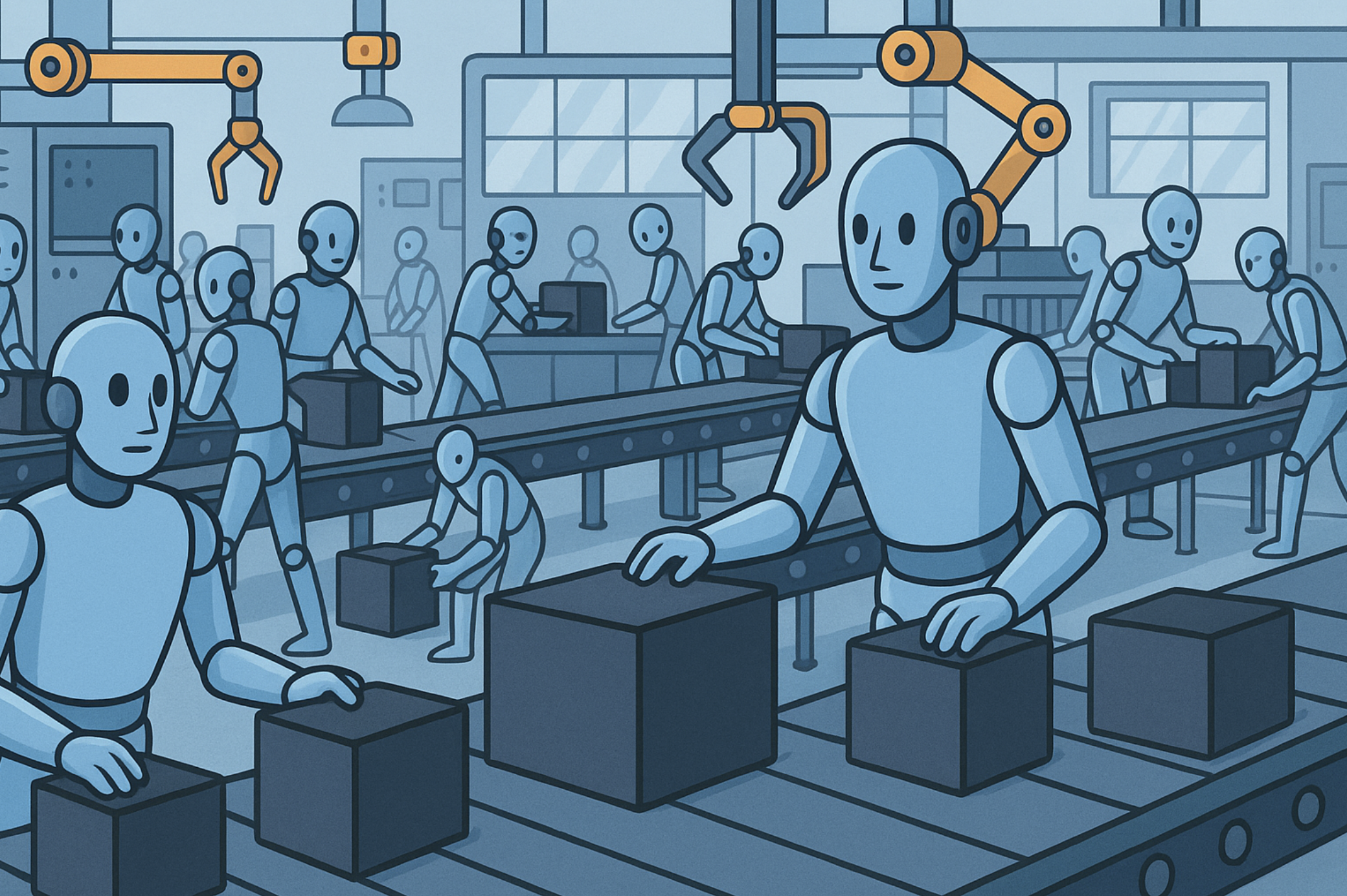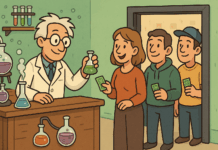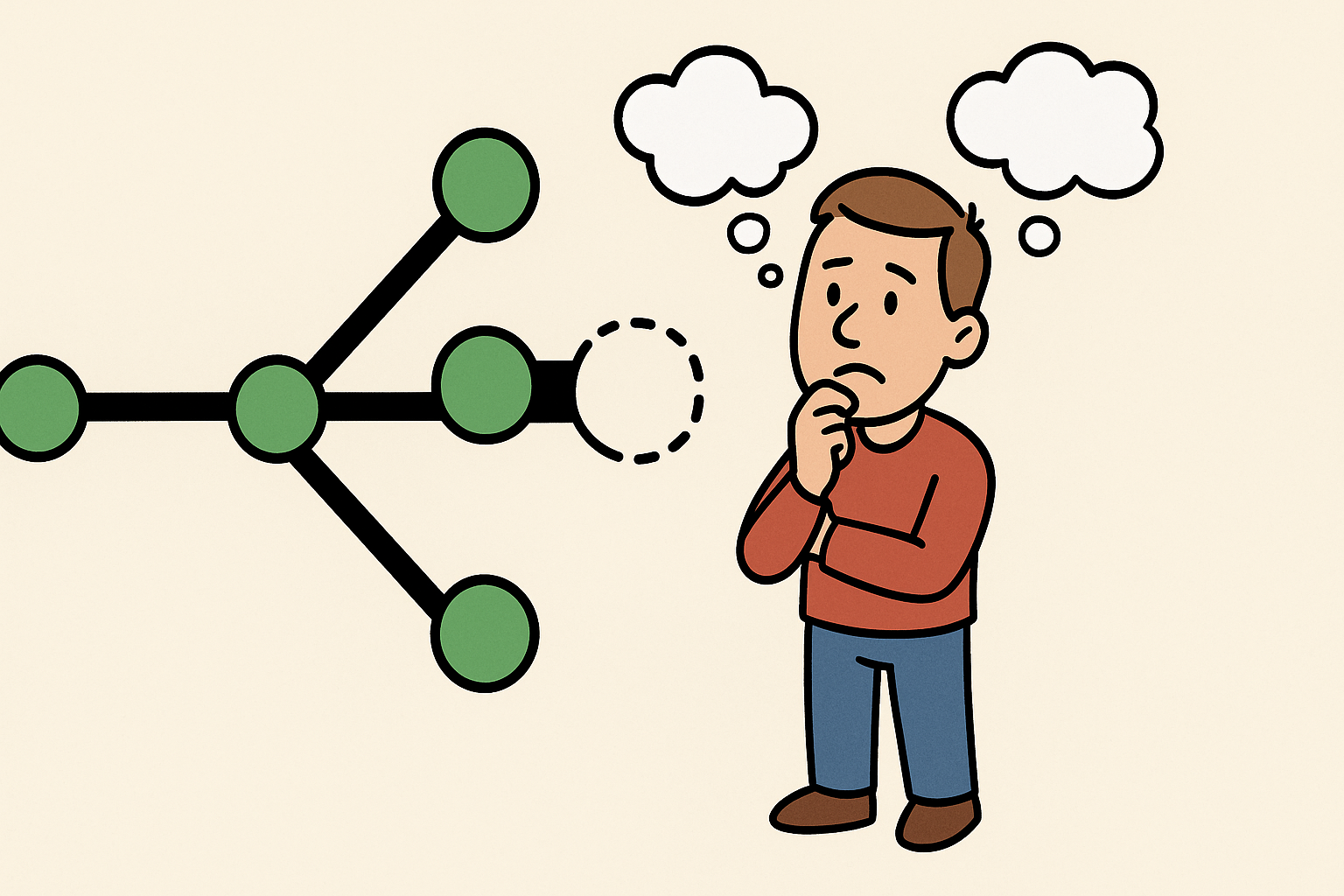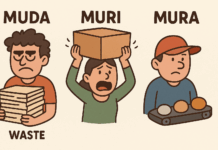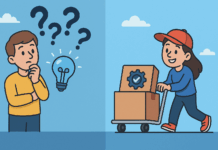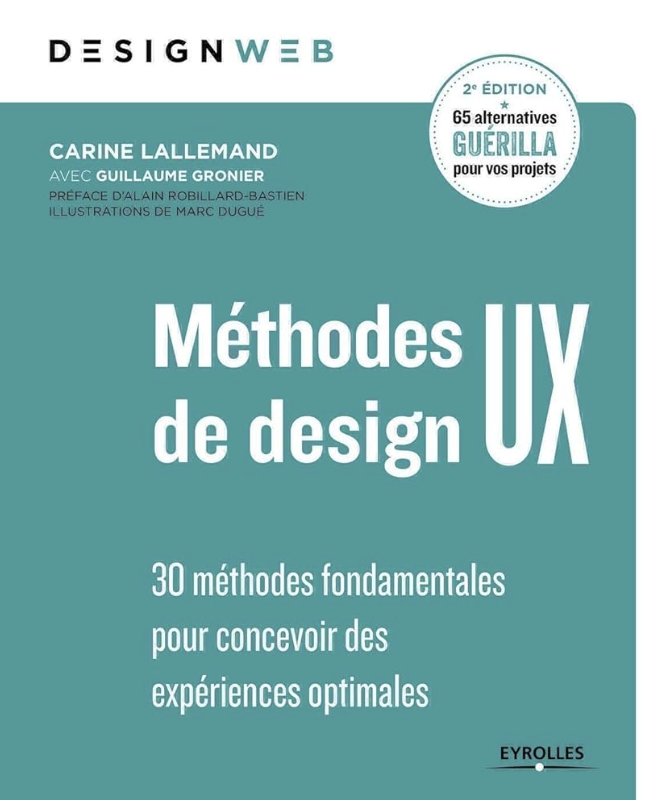Au fur et à mesure de la découverte des usines à impact, on comprend qu’il ne s’agit plus simplement de répartir les rôles selon le schéma classique où le Product Manager et le Product Designer se concentrent sur la Discovery, tandis que les développeurs, guidés par un Product Owner, se chargent de la Delivery. Dans une usine à impact, la frontière entre ces domaines devient plus floue, et surtout, plus systémique.
Le dilemme des périmètres des métiers du produit
La réalité est que chaque phase — qu’elle soit exploratoire ou en production — mobilise des compétences spécifiques en fonction de la nature du test à conduire. Un test d’usage sur un prototype haute fidélité, par exemple, peut être piloté par un Product Designer, accompagné d’un UX Researcher pour la mise en œuvre et l’analyse des retours utilisateurs. Un test d’appétence marché, de positionnement ou de pricing, relèvera davantage du Product Manager, épaulé par un Growth ou un Data Analyst pour l’interprétation des signaux. Et un test technique ou de performance en environnement réel sera naturellement sous la responsabilité d’un développeur ou d’un Tech Lead, qui conçoit la solution instrumentée pour collecter les données nécessaires à la mesure d’impact.
Autrement dit, ce n’est plus la phase du projet ou de la séquence qui définit qui travaille avec qui, mais la nature du problème et du test. Chaque question trouve son propriétaire naturel selon les compétences requises : la compréhension du besoin, la conception de la solution, l’expérimentation, l’analyse des données ou la mise en production. Le leadership produit se distribue alors dynamiquement, en fonction des enjeux d’apprentissage du moment.
Ce changement de paradigme révèle une autre réalité souvent sous-estimée : en termes de charge de travail, les métiers du produit (PM, designers, data, researchers) produisent autant que les développeurs, mais sur d’autres formes de livrables — hypothèses, prototypes, maquettes, enquêtes, analyses, frameworks de décision. Leur production n’est pas moins tangible : elle alimente la connaissance et réduit le risque avant que la moindre ligne de code ne soit écrite.
De ce fait, les équipes dites de Discovery et de Delivery tendent à avoir une taille comparable, et surtout, une interdépendance forte. L’une découvre ce que l’autre doit construire, l’autre valide ce que la première a appris. L’objectif n’est plus de séparer les flux mais de les synchroniser pour maximiser la performance globale du système.
Dans une usine à impact, cette symétrie devient un avantage structurel : chaque cycle, qu’il soit de Discovery ou de Delivery, contribue à la même boucle d’apprentissage.
Résultat : une organisation plus fluide, plus intelligente, et surtout plus performante que les modèles traditionnels — non pas parce qu’elle travaille plus, mais parce qu’elle apprend plus vite.
La complexité réside alors plutôt du côté de l’ordonancement et du bon choix d’outils de gestion des activités.
Auteur de Usines à Impact / Co-fondateur de Shy Robotics / Head of Product chez Dassault Systèmes / Ingénieur passionné d’innovation et d’entrepreneuriat
Bibliographie complète ici