Le networking se tient au NUMA, un espace de coworking vibrant du cœur de Paris, éclairé par des guirlandes de LED d’ambiance et des écrans où défilent des démos futuristes. À peine le seuil franchi, Sophie est traversée par un mélange d’excitation et de trac. Deux hôtes leur tendent des autocollants : prénom à inscrire, puis petits drapeaux pour signaler les langues parlées – cosmopolitisme oblige. À la surprise de Sophie, l’espéranto figure même parmi les options.
Elle et Julien s’exécutent ; ce dernier ne résiste pas au plaisir de dessiner un minuscule melon à côté de son prénom. Autocollants en place sur la poitrine, Sophie croise son regard et souffle : « Prêt à socialiser ? » murmure-t-elle, mi-défi, mi-encouragement. « Autant qu’on puisse l’être, » réplique Julien en balayant la salle des yeux. Ils s’éloignent alors, chacun vers un groupe différent, happés par le brouhaha multilingue et les promesses d’idées neuves.
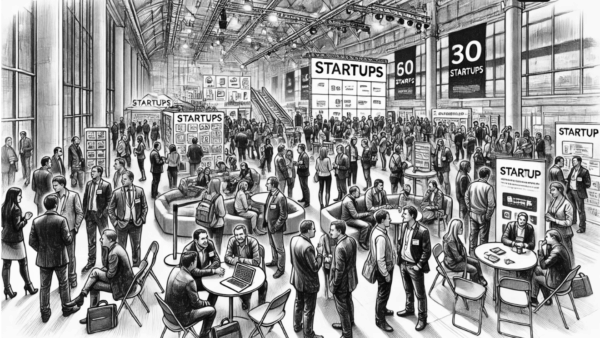
En circulant parmi les entrepreneurs, Sophie aborde les personnes présentes avec curiosité et enthousiasme. « Quel projet passionnant vous amène ici ce soir ? » demande-t-elle pour ouvrir la porte aux échanges. À chaque réponse, elle écoute attentivement, et relance avec des questions de plus en plus pointues : « Comment avez-vous surmonté vos premiers défis ? » ou « Quelles stratégies envisagez-vous pour évoluer ? »
Sophie passe de conversation en conversation, tend l’oreille à des histoires d’amorçage, de démissions en attente, de doutes murmurés entre deux verres. Certains en sont encore au stade du PowerPoint caché dans un tiroir de bureau. D’autres ont déjà levé des fonds, survécu à un pivot ou deux. Peu à peu, sa vision de l’entrepreneuriat se nuance, et ses propres incertitudes perdent en gravité.
C’est en s’approchant d’une table un peu en retrait, occupée par un petit groupe qui rit doucement, qu’elle remarque Max. Il est là, posé, tasse en main, sourire calme, regard attentif. Elle ne le connaît pas encore, mais il dégage une présence rare, le genre de personne que vous avez l’impression d’avoir déjà rencontré par le passé, et qui donne confiance rien qu’en croisant son regard. Le groupe se disperse, ne reste que lui.
Elle hésite une seconde, puis s’avance. « Salut, moi c’est Sophie. Je bosse sur un projet qui s’appelle MelonsNet. ». Il incline légèrement la tête. « Intéressant. Dis m’en plus ! ».
Elle enchaîne, lui résume en quelques phrases leur idée de casque de lecture de pensées, les débuts, les ambitions. Il l’écoute sans l’interrompre… jusqu’à ce qu’il le fasse. « Dis-moi, Sophie, quel besoin vous cherchez vraiment à combler ? ».
La question est tombée sans détour, avec la simplicité désarmante de celles qui obligent à un temps de réflexion. Sophie réalise qu’elle ne s’est jamais interrogée en détail sur ce point. Bien que décontenancée, elle se reprend et commence à décrire leur technologie avec une fierté évidente. « Alors, notre casque de lecture de pensées repose sur des capteurs de pointe, inspirés des recherches de Stephen Wolpaw sur les interfaces cerveau-machine. Ces capteurs captent les ondes cérébrales et les traduisent en impulsions électriques, un peu comme l’EEG mais en plus complexe » explique-t-elle. « Ensuite, nous avons développé une interface de machine learning qui interprète ces signaux bruts. Pour ça, on s’appuie sur les algorithmes de réseaux neuronaux profonds, comme ceux explorés par Yoshua Bengio, afin d’affiner les prédictions en temps réel. »
Le silence de Max déstabilise légèrement Sophie, mais elle poursuit, portée par l’élan de sa passion. Ses yeux brillent, animés par l’envie de convaincre.
« Notre système de filtres, explique-t-elle, s’inspire des travaux de Marvin Minsky sur la reconnaissance des émotions. En clair, on ne transmet pas toutes les pensées, mais seulement certaines catégories : émotions, intentions… C’est ce qui rend notre casque unique. On ne se contente pas de lire des impulsions électriques. On interprète des schémas mentaux, des structures de pensée. On capte l’essence de ce que l’utilisateur veut dire, au moment où il le pense. »
Max l’écoute, toujours le même sourire chaleureux aux lèvres, mais sans laisser deviner la moindre pensée. Lorsqu’elle termine, le silence s’installe. Il dure. Longtemps. Trop longtemps. Sophie reste figée, tendue comme une corde en attente d’un verdict.
Puis, calmement, presque avec douceur, Max prend la parole : « C’est impressionnant, vraiment. Et on sent que tu maîtrises ton sujet. ». Il marque une pause. « Mais… quel besoin cherchez-vous à combler ? »
Sophie reste interdite un instant, puis prend une autre approche. « Eh bien, notre casque permet de briser les barrières entre les individus, d’améliorer la compréhension mutuelle, de réduire les conflits… En fin de compte, il contribue à l’humanité. »
Max incline légèrement la tête, comme s’il cherchait à voir le projet sous un autre angle. « Je comprends », murmure-t-il. « Mais avez-vous identifié des cas d’usage concrets ? »
Sophie hoche vivement la tête. « Bien sûr ! En réunion, par exemple, il pourrait faciliter la compréhension entre les participants. Et imagine les négociations diplomatiques, où chaque nuance compte… Le champ des possibles est immense. »
Mais le regard de Max reste impassible. Il laisse passer un court silence, plus inconfortable que les précédents, puis enchaîne, plus direct : « Est-ce que des diplomates ou des animateurs de réunion utilisent déjà votre casque ? »
Sophie baisse légèrement les yeux. « Non… pas encore. Le casque n’est pas assez abouti pour ça. »
Max ne la lâche pas, mais son ton reste calme. « Et avez-vous parlé avec eux ? Savoir s’ils seraient intéressés, même en théorie ? »
Elle baisse encore le regard, la voix moins assurée. « Non… sans prototype, ils ne verraient pas l’intérêt… »
Max observe un instant son visage, attentif à la moindre inflexion. Puis, sans hausser le ton, il pose la question qui suspend l’instant : « Alors, comment sais-tu que votre casque répondra vraiment à ces besoins ? »
Sophie se tait, sentant la subtilité de la question. Pour la première fois, elle réalise que, malgré les possibilités techniques, la définition des besoins spécifiques manque peut-être de solidité.
Julien, qui écoutait la conversation à quelques pas de là, s’approche discrètement. Sophie en profite pour faire les présentations officielles, et Max félicite le duo pour les avancées impressionnantes de leur projet. Mais soudain, il jette un coup d’œil à sa montre, sursaute légèrement, puis s’excuse pour son départ précipité. Il tend une carte à chacun, griffonne une adresse mail au dos, et les regarde successivement dans les yeux.
« Promettez-moi de passer à l’incubateur. Je peux vraiment vous aider à franchir cette étape cruciale », leur dit-il, le sourire franc, teinté d’une énergie contagieuse. Puis il s’éclipse dans le tumulte de la soirée, laissant derrière lui un mélange d’enthousiasme, de doutes… et une étrange impression de rendez-vous manqué.
Julien et Sophie, inspirés par leurs rencontres mais un peu fatigués, décident de rentrer eux aussi. En quittant le NUMA, ils se promettent de débriefer le lendemain au bureau de leurs découvertes et idées pour mieux avancer vers la levée de fonds. En rentrant chez elle, Sophie prend quelques instants pour appeler sa sœur, qui s’occupe de son fils, lui promettant de passer du temps le weekend prochain pour l’emmener au zoo.
Le lendemain, Sophie et Julien se retrouvent avec l’équipe de MelonsNet au bureau pour une nouvelle journée. Comme chaque matin, Julien démarre par le rituel d’équipe de quinze minutes où chacun récapitule les objectifs de la journée et les points de blocage qui nécessitent de l’aide ou le décalage de certaines échéances. Sophie et Julien évoquent leur rencontre de la veille avec Max et prévoient de prendre la décision de la suite à donner dans l’heure qui suit la réunion d’équipe. Les développeurs en profitent pour partager qu’ils doivent ré-étalonner le casque de lecture de pensées car ils ont découvert un problème dérangeant : lorsque quelqu’un s’approche trop près, le casque confond les informations du porteur avec celles de la personne qui passe à côté.
Après cette session, Julien et Sophie s’isolent dans une salle de réunion pour discuter de leurs rencontres de la veille. Sophie rompt le silence en se penchant vers Julien. « Max m’a vraiment déstabilisée avec ses questions sur le cas d’usage » confie-t-elle. « Je comprends qu’il veuille des exemples concrets, mais il n’arrêtait pas d’y revenir comme si c’était la seule chose qui comptait. On est en train de révolutionner le monde en créant une technologie qui fera émerger de nouveaux besoins comme le Smartphone et les humanoïdes l’ont fait par le passé, et ils nous demande de discuter avec des utilisateurs qui seront incapables de se projeter dans notre technologie. Il est un peu à côté de la plaque… »
Julien hausse les épaules, agacé. « Entièrement d’accord ! Franchement, ça m’échappe. À quoi bon se concentrer autant sur les cas d’usage si notre produit n’est même pas prêt ? C’est un peu idiot, non ? On est encore en train de finaliser le casque, et lui, il veut déjà des preuves d’utilisation concrètes. Il n’a pas compris ce qu’on faisait… »
Sophie le regarde, une lueur d’hésitation dans le regard. « En même temps, il accompagne des startups… et on sait bien qu’on est passés à côté de quelque chose. Il nous manque peut-être un point d’ancrage, quelque chose de solide pour structurer notre développement. »
Julien secoue la tête, sceptique. « Il y a aussi beaucoup de vendeurs de rêves dans les incubateurs. Regarde tous ces dispositifs publics qui se vantent du nombre de startups accompagnées, mais jamais des emplois créés ou de l’impact réel. Leurs pitchs, c’est toujours les financeurs, les partenaires institutionnels… jamais les clients ni les vrais résultats. Ils se sont spécialisés dans la levée de fonds publics au mépris de nos impôts. »
Il marque une pause, puis ajoute avec un ton plus grave : « Et souvent, ils recrutent des anciens entrepreneurs qui ont échoué et cherchent encore la recette miracle. Alors ils testent des méthodes sur les nouveaux, en misant sur leur énergie naïve. Avant de foncer, prenons le temps de creuser un peu sur l’incubateur de Max. Tu veux bien ? »
Sophie acquiesce lentement, songeuse. « Tu me fais penser à un ami américain, dit-elle. Il se moquait gentiment de nos incubateurs français. Selon lui, pendant que les leurs comme YC sont animés par des entrepreneurs à succès, les nôtres embauchent ceux qui ont échoué. Il trouvait ça presque rassurant, ajoutait-il avec un sourire, parce que ça voulait dire qu’on ne risquait pas vraiment de leur faire concurrence. »
Julien esquisse un sourire, mais elle poursuit, plus sérieusement : « Il disait aussi qu’aux États-Unis, les grandes entreprises rachètent les startups dès que leur valorisation s’envole. Ici, on attend qu’elles s’écrasent pour les racheter à bas prix. Il avait entendu parler de Bernard Tapis et avait trouvé impressionnant qu’une personne ait pu surfer sur cette particularité culturelle pour réussir dans l’entrepreneuriat. Il avait conclu en comparant ça à une école d’ingénieurs de prestige qui sélectionnerait ses candidats en commençant par les moins bons. »
Un silence suit, chargé de constat. Comme pour se rassurer, Julien ajoute. « Ils sont quand même arrogants ces Américains, on est pas si nuls en France… Et je suis sûr qu’ils font pareil. Il n’a regardé que les plus gros acteurs qui ont plein de moyens pour tirer cette conclusion ». Puis, tous deux s’attèlent à leur recherche : articles de presse, témoignages d’anciens incubés, historiques d’accompagnement. Rapidement, les faits parlent d’eux-mêmes. L’incubateur Vonaroga, dirigé par Max, affiche un taux de réussite remarquable. Des startups devenues emblématiques y ont vu le jour, certaines aujourd’hui mondialement connues.
Julien repose sa tablette, pensif. « On ne peut pas rester dans cette confusion ».
Sophie relève la tête et fixe Julien. La décision est prise : ils vont recontacter Max. Au bout de quelques minutes de conversation téléphonique, il leur donne rendez-vous dans le café d’un hôpital où il se trouve actuellement.
Julien fronce les sourcils. « Un hôpital ? C’est quoi, ce rendez-vous ? ».
Une heure plus tard, ils se retrouvent sur le lieu, leurs esprits en ébullition, impatients d’enfin comprendre pourquoi Max est si insistant sur le sujet des cas d’usage. Assis dans le café, dans l’atmosphère animée de l’hôpital, ils expliquent leur problème à Max. « Nous avons dû rater quelque chose quand nous nous sommes vus. Nous n’avons pas compris comment tu imagines valider un cas d’usage si le casque n’est pas fonctionnel » avoue Julien.
Max les écoute en silence, attentif, les mains croisées devant lui. Puis, avec un sourire rassurant, il prend la parole d’une voix posée. « Vous traversez une phase complexe, mais classique pour les créateurs de startups innovantes. »
Il marque une pause, les regarde tour à tour, puis enchaîne. « Il y a plusieurs profils de fondateurs. Certains commencent avec une technologie prometteuse mais tâtonnent encore côté commercial. D’autres ont une idée claire du marché, une vision business, et cherchent la techno qui pourrait la concrétiser. Certains identifient un besoin — plus ou moins bien cerné — et essaient de le résoudre. Et puis, il y a ceux qui n’ont ni techno ni besoin précis, mais une énergie folle, une capacité à rassembler et à s’adapter, misant sur la rencontre d’une opportunité au bon moment. »
Il les regarde avec bienveillance. « Dans votre cas, la technologie est là. Ce qui vous manque, c’est un besoin clair, tangible, urgent. Un problème qui mérite vraiment d’être résolu. »
Sophie et Julien acquiescent, pensifs. Julien finit par dire : « On est assez visuels… Tu pourrais nous faire un schéma pour illustrer ça ? »
Max esquisse un sourire, attrape un feutre et se dirige vers le tableau blanc accroché au mur. Il trace quatre colonnes : Solution, Besoin, Business, Motivation. « Voici les quatre piliers sur lesquels se structurent la plupart des projets. Chaque startup démarre avec un ou deux de ces axes forts. »
Il inscrit MelonsNet dans la colonne Solution, puis souligne Motivation d’un trait appuyé. « Chez vous, la solution technologique est ambitieuse, et l’énergie de l’équipe est manifeste. Mais les deux autres colonnes — besoin et business — restent presque vides. »
Julien croise les bras, pensif. Sophie reste concentrée. Max poursuit, sans détour. « Il y a deux grandes familles de startups. Celles qui vivent grâce à leurs clients dès le début, qu’on appelle les bootstrappers. Et celles qui nécessitent des investissements lourds — souvent pour financer la R&D ou parce qu’elles visent un modèle de masse à faibles marges. MelonsNet, vous l’avez positionnée comme une startup deeptech, mais si on regarde froidement, même votre axe fort, la R&D, est sous-dimensionné. Deux développeurs à temps plein, deux stagiaires en roulement… c’est très mince. »
Il se tourne vers eux. « Vous avez eu de la chance de trouver des stagiaires brillants, disponibles hors calendrier académique. Mais ça ne suffira pas. »
Le silence qui suit est dense, presque palpable. Julien garde les bras croisés, le regard sombre. Il finit par rompre le calme. « Je comprends ton point de vue, Max, mais ça ne résout pas le vrai problème : comment veux-tu intéresser des utilisateurs si le casque n’est même pas terminé ? »
Max ne se démonte pas. « Julien, il ne s’agit pas de le vendre ou de le faire utiliser maintenant. »
Julien hausse un sourcil, piqué. « Je n’ai jamais parlé de vente. »
Max incline légèrement la tête. « Tu as évoqué l’intérêt pour un casque terminé. On n’en est pas loin. Mais ce n’est pas le sujet. Il ne s’agit pas d’aboutir à un produit avant d’aller chercher des utilisateurs. Il s’agit d’investigation. D’exploration avant de développer quoi que ce soit. Comment pouvez-vous savoir ce que vos futurs utilisateurs attendent — en termes de fonctionnalités, de performance, d’ergonomie — si vous n’avez pas identifié de cas d’usage concret ? Ce n’est pas le produit qui doit guider vos décisions, mais les informations tirées du terrain. Ce sont elles qui tracent la route. Ce sont elles qui fixent un cap et donnent un sens aux délais. »
Son ton devient plus engageant. « Et pour répondre à ton inquiétude, il est tout à fait possible de vendre un produit qui n’existe pas encore, tant que vous montrez une vision claire et que vous inspirez confiance. Prenez l’exemple de l’A380 d’Airbus. Lorsqu’ils ont proposé cet avion aux compagnies aériennes, il n’était rien de plus qu’un projet sur des plans. Aucune maquette fonctionnelle, aucun prototype, juste des simulations, des modèles financiers, et une vision ambitieuse. Et pourtant, ils ont réussi à convaincre plusieurs compagnies de signer des commandes fermes. »
Voyant l’intérêt de Julien grandir, Max ajoute des détails. « Les équipes d’Airbus ont d’abord identifié les besoins des compagnies aériennes, comme le transport d’un plus grand nombre de passagers sur des distances longues tout en réduisant le coût par siège. Ensuite, ils ont présenté comment l’A380 répondrait à ces attentes grâce à ses dimensions inédites et son efficacité énergétique. Ils ont même utilisé des modèles économiques pour prouver que les coûts d’exploitation à long terme compenseraient largement l’investissement initial. Ils ne vendaient pas un avion, Julien, ils vendaient une solution à des problèmes concrets. »
Max s’approche, le regard intense. « Ce que je te dis, c’est que vous pouvez faire la même chose. Si vous comprenez parfaitement les besoins réels de vos utilisateurs, vous pourrez non seulement orienter votre développement, mais aussi commencer à construire une relation de confiance avec vos futurs clients, même si le produit n’est pas encore fini. »
Julien et Sophie, désormais convaincus par la démarche, échangent un regard complice avant que Julien ne se tourne vers Max. « D’accord, on voit où tu veux en venir, » commence-t-il. « Mais concrètement, par quoi on commence pour lancer cette investigation ? »
Max, heureux de leur avancée, répond. « Pour identifier un besoin, vous devez rencontrer des gens. Pas nécessairement ceux qui ont directement ce besoin au départ, mais au moins des personnes qui peuvent vous donner des pistes ou vous orienter vers les bons interlocuteurs. »
Max se lève alors et présente Léo, qui vient de passer la porte du café. « Je lui ai demandé de passer car il a déjà lancé plusieurs entreprises innovantes dans l’incubateur où je travaille. Quand je lui ai parlé de vous tout à l’heure, il a dit qu’il était justement dans le coin. »
Léo s’approche, souriant, et serre la main de Julien et Sophie. « Salut, j’ai entendu dire que vous aviez besoin de quelques conseils pour sauver votre entreprise. Je serais ravi de vous aider. »
Témoignages d’entrepreneurs et de product managers
Pour prendre du recul sur le contenu de ce chapitre, je vous propose une série de témoignages inspirants.
🎥 Visionner les vidéos
Lydian Feneck, fondateur de Gamearly, raconte comment négliger l’approche par la communauté peut amener à rater la valeur d’un produit.
Sébastien Tricoire, CTO de Cezigue, raconte comment les incubateurs fédèrent les communautés pour maximiser les chances de réussite des entrepreneurs.
Anil Narassiguin et Pierre Vidal, co-fondateurs de FlyRenov, développent la façon dont les problèmes vécus peuvent servir à développer un réseau.
Paul Benoit, CEO de Qarnot Computing, raconte l’approche organique du développement d’un réseau autour d’un projet.
Christophe Remillet, co-fondateur de OneVisage, expose l’expérience professionnelle comme vecteur de développement d’un réseau.
Auteur de Usines à Impact / Co-fondateur de Shy Robotics / Head of Product chez Dassault Systèmes / Ingénieur passionné d’innovation et d’entrepreneuriat
Bibliographie complète ici